Introduction
Ce n'est qu'en janvier 2007 que la NASA s'est enfin décidée à franchir le pas en adoptant le système métrique. Cette importante décision, largement sollicitée par les scientifiques de l'Agence spatiale, intervient à la suite de l'échec de la mission martienne Mars Climate Orbiter en 1999.
Lorsque la sonde dut se satelliser autour de la planète rouge, un véritable embrouillamini entre les unités de distance programmées par divers sous-traitants, quelquefois en kilomètres, quelquefois en milles, s'était traduit par un ordre transmis à l'ordinateur de bord, qui aboutissait à tenter de placer l'engin spatial sur une orbite située à… 60 kilomètres sous la surface.
Il est particulièrement croustillant de noter que cette décision, qui a tout de même mis près de huit années à s'imposer, intervient alors qu'excepté les Etats-Unis, seule la Birmanie et le Libéria mesurent toujours officiellement les distances en milles. Si la NASA avait déjà commencé, assez timidement, à utiliser le système métrique dès 1990, les mesures en milles, livres et gallons prévalent toujours dans les programmes concernant la navette spatiale et la Station Spatiale Internationale.
Ben Quine, professeur d'ingénierie spatiale de l'université d'York, ironise en affirmant que son unité de mesure préférée à lui, s'est le Slug. Le Slug, déclare-t-il, est défini comme la masse qui, soumise à une force d'une livre, reçoit une accélération d'un pied/seconde par seconde. Plus sérieusement, il signale que si le passage d'un système à l'autre ne sera pas forcément aisé pour tout le monde, les calculs en seront à la longue facilités.
Et il ajoute: "Le pied est défini d'après la taille du pied d'un des rois d'Angleterre. Je ne me souviens pas lequel. Ce n'est vraiment pas une bonne façon d'envoyer des gens dans l'espace que de se baser sur la taille du pied d'un roi mort."
L'histoire
des unités ( de longueur , d'aires , de capacité , de
poids ...) est relativement complexe.
Au Moyen Age, il existait beaucoup d'unités
dans le royaume de France ; par exemple :
- l'aune, la quarte,
le setier comme
unités de volumes pour les grains et les liquides ;
- le
pied et la toise comme unités de longueurs pour les tissus, les
meubles et les bâtiments ;
- l'arpent
comme unité de surface pour les terrains...
Pour
donner une idée de la complexité de la définition
des mesures, citons un texte d’Ambroise Paré, relatif au grain,
datant de 1575. Les poids sont définis à partir :
“du grain, qui est comme élément des autres poids auquel
ils sont terminés. Le dit grain doit estre entendu d’orge, non trop
sec ny humide, et chancy (moisi), mais bien nourri et médiocrement gros
: de tels 10 grains est faict un obole ou demy scrupule : de 2 oboles ou 20 grains,
un scrupule, puis de 3 scrupules ou 60 grains est composée la dragme.
De 8 dragmes l’once étant, que de 12 onces nous faisons la livre
médicinale, qui est presque le plus haut poids duquel nous usons communément ”.
Il faut "faire avec", sans calculatrice, sans même, le plus souvent, être
allé à l’école !
De plus, suivant les lieux, à un même nom correspondent parfois
des valeurs différentes. Ces mesures, peu fiables, manquent de précision
dans leur définition même.
Bien sûr, pas d’étalon possible : comment retrouver la valeur
d’origine de la toise, dite de Charlemagne, compte tenu de son évolution
avec le temps ?
La plupart des métiers étaient organisés en corporation
et chaque corporation avait ses propres unités de mesure qui figuraient
sur les instruments gradués.
Cependant, avec les échanges et le déplacement des ouvriers
qui faisaient le tour de France, elles s'uniformisaient. Ainsi, la longueur
appelée pied du Roi (mesurant l'équivalent de 32,4 cm) fut
imposée.
Ailleurs aussi, les choses n'étaient
pas simples...
- la
coudée égyptienne est une unité de longueur désignant
la distance entre le coude et le bout du majeur , soit environ 50 cm. Une
coudée
standard fut établie sur du granite noire : la coudée royale
mesurant environ 52,4 cm ; celle-ci servait de modèle à toutes
les autre coudées.

- Le
pied humain fut utilisé comme unité de mesure vers 1500 avant
JC par les Babyloniens, équivalent à 33 cm environ. Le
pied romain mesurait environ 30 cm et le pied grec 30 cm.
- Le
yard est une unité utilisée en Grande Bretagne et valant
environ 0,9144 m. Elle a été inventée par les
marchands pour mesurer les tissus. Chaque yard désignait une
longueur de tissu tendue entre le menton et le bout des doigts. Au
XIIe siècle,
elle fut déterminée comme étant égale à la
distance entre le nez du roi Henri Ier d'Angleterre et le bout de son médium...
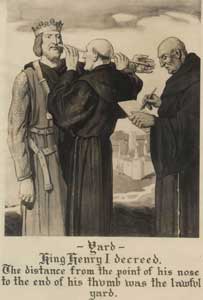
La
création du système métrique avait pour but de simplifier
l'usage des poids et mesures en créant des unités communes à tous.
Le
12 juin 1790, Condorcet proposa lors d'un discours devant l'assemblée
nationale de créer "une unité de longueur naturelle et
invariable".
« Si l'on considère
les mesures d'un même genre rangées
par ordre décroissant, chacune est dix fois plus petite que celle qui
la précède immédiatement et dix fois plus grande que celle
qui la suit».
Le
système métrique décimal rendait les calculs simples
et faciles ; il dispensait également de l'énumération
des subdivisions. Dans l'ancien système, il fallait par exemple écrire
: 12 livres, 3 sous, 18 deniers ou encore 11 muids 4 setiers 3 minots.
Un
tel système a simplifié le calcul des surfaces et des volumes
en faisant "glisser" la virgule de deux ou trois rangs vers la droite
ou vers la gauche par passage à un multiple ou à un sous-multiple.
Le
système décimal est obligatoire en France depuis 1837, et
est utilisé par la plupart des pays. Jusqu'à aujourd'hui, seuls
deux pays n'ont pas encore adopté les unités du SI : le Bangladesh
et le Libéria. Il faut aussi noter que certains pays comme les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne utilisent encore d'autres unités (comme le mile
utilisé au lieu du kilomètre ; 1 mile = 1609 m).
L'usage
d'étalons
universels, invariables, définis avec précision
et conservés avec soin, ne s'est imposé qu'aux XVIIIe et XIXe
siècle. Les savants de l'époque ont rattaché les mesures à un
nombre restreint d'étalons : mètre, kilogramme, seconde, ampère,
kelvin, candela, mole. Les unités dérivées s'en déduisent à l'aide
de définitions, relations physiques entre les grandeurs de base et
les grandeurs dérivées. Par exemple, l'unité de force
du SI est le Newton et elle s'obtient en multipliant la masse par l'accélération.
Les étalons
fondamentaux que sont le méridien terrestre, le
jour solaire et l'eau pure permettent de définir les unités de
base : le mètre, la seconde et le kilogramme. Ils permettent également
de définir les unités dérivées : surface, volume,
vitess , accélération, force, travail, puissance...
Afin d'acquérir
plus de précision, l'étalon
de longueur (qui a tout de même gardé la même valeur) a d'abord été le méridien terrestre, puis une règle en platine iridié,
puis la longueur d'onde d'une radiation du krypton. En 1983, il
a été défini
comme étant égal au trajet parcouru par la lumière en
un 299 792 458ième de seconde pour que sa longueur coïncide avec
celle que définissait l'étalon précédent.
Le
mètre a été créé en
1747 et défini
dans un permier temps comme "la dix-millionième partie du quart
du méridien terrestre" ; c'est-à-dire le
dix-millionième
de la distance séparant le pôle nord de l'équateur
(distance entre Dunkerque et Barcelone).

Jean-Baptiste Joseph Delambre (1749-1822) et Pierre Méchain (1744-1804),
astronomes, vont se charger de la mesure de l'arc du méridien par
triangulation, méthode inventée par le hollandais Willebrord
Snellius au début du XVIIème siècle : il suffit de
jalonner le méridien par un réseau de points constituant
des triangles juxtaposés, deux triangles successifs ayant un côté commun,
et de déterminer uniquement par des visées les angles
de ces triangles.
La
mesure réelle d'un seul des côtés de l'un des triangles
(la base) permet d'obtenir par le calcul la longueur de tous les autres,
et par projection d'obtenir la distance sur terre, au niveau de la mer, entre
les points extrêmes. Il s'agit d'une combinaison de mesures géodésiques,
d'arpentage et de mesures astronomiques.
Deux
bases de référence d'environ 6000 toises (11,7 km) sont
utilisées : l'une entre Melun et Lieusaint et l'autre entre Vernet
et Salses (près de Perpignan).
Les mesures vont durer, en fait, de
1792 à 1798

D'autres
unités ont en même temps été créées
:
Le
litre (pour les
capacités) : il avait été défini
en 1901 comme étant le volume occupé par 1 kg d'eau pure à la
température de 4°C et sous la pression de 760 mm de mercure
.
1
L = 1,000 028 Cette définition a été annulée
en 1964. Le litre peut être utilisé comme un nom spécial
donné au dm3.
L'unité de
masse, le kilogramme, fut choisi comme la masse d'un litre d'eau pure à 4°C
et à une pression fixée. Une fois
ces mesures établies, les scientifiques créèrent un étalon
fait en platine iridié, l'un des métaux les plus stables connus
au 19e siècle ; ces étalons ne devaient ni varier en longueur
et en masse, ni s'user, ni se dilater. Le mètre et le kilogramme
furent les deux premières unités adoptées en 1799 pour
former la base du système métrique.
En
1832, Gauss proposa d'ajouter la seconde.
Elle fut définie comme étant égal à 1 /
86 400 jour.
Ce système
de trois unités, baptisé "système M K S" (initiale de
chaque unité) fut officiellement adopté en
1889 par la première Conférence générale
des Poids et Mesures.
En 1901, Giorgi
a
introduit l'ampère comme quatrième unité pour
mesurer l'intensité d'un courant.
Le
scientifique suédois Anders Celsius (1701 - 1744) avait mis au
point un appareil permettant de mesurer des températures (un thermomètre)
pour ses observations météorologiques.

Il
a choisi de graduer le thermomètre avec l'échelle suivante :
le 0 représente
la température d'ébullition et le 100 correspond à la
température de congélation de l'eau. Cette unité fut appelée
degré Celsius et notée °C. L'échelle
des températures
a depuis été inversée. Cependant, un tel choix pose deux
problèmes : il peut y avoir des température négatives
d'une part, d'autre part la température de congélation et d'ébullition
de l'eau n'est pas la même partout sur le Terre. Les progrès de
la chimie au 18e siècle ont permis de mettre en évidence qu'il
est impossible de descendre en dessous d'une certaine température ;
cette température est appelée le zéro absolu et correspond à -
273,15 °C. Ainsi, pour éviter les températures négatives,
les scientifiques ont créé le degré Kelvin dont de zéro
est le zéro absolu et un écart de 1 kelvin correspond à un écart
de 1°C.
La température
de congélation et d'ébullition de l'eau
dépend de la pression (la température d'ébullition de
l'eau baisse avec la pression). Quand celle-ci atteint 611,2 pascals, la
température de congélation et de fusion sont confondues : à cette
pression, à la température de 0,01°C ( 273,16 K), la glace
se transforme directement en vapeur. Ce point est appelé point triple
de l'eau (point de rencontre des trois phases de l'eau : glace, liquide et
vapeur) et il a l'avantage d'être indépendant de l'endroit où la
mesure est effectuée.
En
1954, le kelvin fut donc officiellement adopté comme unité de
mesure de température : un kelvin est défini comme étant
1 / 273,16ème de la température du point triple de l'eau.
Pour
les températures habituelles, l'usage du degré celsius
est admis. Pour passer de l'un à l'autre : 1 kelvin = 1 degré celsius
et 0°C = 273,16 K . Remarquons que pour éviter la confusion entre
les degrés celsius et kevin, on parle de kelvin et non de degré kelvin.
L'unité de
référence pour l'intensité lumineuse était
celle des "bougies" (de vraies bougies au début puis plus
tard piles électriques). Cependant, toutes les
lampes n'émettant
pas de la lumière avec la même intensité ni avec la même
couleur, une unité universelle fut choisie pour l'intensité lumineuse
et incorporée au système métrique en 1954, appelée
candela et noté cd. En 1979, cette
définition fut modifiée
pour choisir une lampe émettant une couleur bien précise avec
une puissance définie (la puissance étant caractérisée
par l'énergie émise dans une direction donnée).
En
1960, la onzième Conférence Générale des Poids
et Mesures décida d'appeler les système métrique "système
international d'unités" (SI ).
Enfin
la dernière unité utilisée pour la "quantité de
matière" est la mole (noté mol). Une mole correspond à 6.0221415
. 1023 atomes.
Elle
fut ajoutée en 1969 aux autres unités du système métrique.
Les
scientifiques ont été gênés par certaines
grandeurs naturelles qui se sont révélées non
constantes, comme
la durée d'un jour moyen par exemple qui varie d'année
en année.
La seconde est désormais définie comme étant
la mesure de la radiation d'un atome de césium ; la longueur
du mètre
est définie par la vitesse de la lumière. Seul
le kilogramme a encore une valeur officielle définie par un étalon
et non par une quantité facilement
mesurable. En effet, pour définir la masse d'un kilogramme
de façon
très précise, il faudrait être capable de compter
le nombre d'atomes dans un volume donné, ce qui est actuellement
impossible. L'étalon
de masse est conservé à l'abri des poussières,
il n'est manipulé que très rarement à l'aide de
pinces garnies de peau de chamois. Sa masse n'a (presque)
pas varié en
plus de cent ans (en fait, sa masse
aurait augmenté de plusieurs µg à cause d'une très
légère oxydation).
